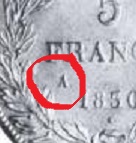les 17
ateliers en 1789
A : Paris
AA : Metz
B : Rouen
BB : Strasbourg
D : Lyon
H : La RochelleI : Limoges
K : Bordeaux
L : Bayonne
M : Toulouse
MA : Marseille
N : Montpellierpetite vache: Pau
Q : Perpignan
R : Orléans
T : Nantes
W : Lille
 :
Bruxelles (1939)
:
Bruxelles (1939)
Madrid
( ):
Flans préparés à Madrid, Berne et
Utrecht 1916
):
Flans préparés à Madrid, Berne et
Utrecht 1916
Poissy
( ):
POISSY (société française de monnayage)
1922-1924
):
POISSY (société française de monnayage)
1922-1924
le mat
: Utrecht 1812-1813
Les autres
ateliers ayant existés
A : arras
(1640-1658)
B : Beaumont-le Roger (1940 et 1943-1958)
B : Dieppe (1592-1594)
BD : béarn (1675-1704)
C : castelsarrasin (1914 - 1942-1946)
C : Caen(1655-1658, 1693-1712)
C : Saint lô :(1539-1653, 1659-1693)
CA : Francfort ville libre (1618-1636)
CC : Gênes (1805)
CL : Gênes (1811-1814)
D : Vienne (dauphiné) (1655-1658)
E : Melun sur Loire (1655-1658)
E : Tours (1539-1655; 1659-1772)
F : Angers (1539-1738)
G : Genève pour la france (1799-1805)
G : Poitiers (1539-1772)
G : Grenoble (1489-1503)
H-A : La Rochelle (1539-1837)
I : Limoges (1766 - 1837)
L couronné : Lille (1686-1693)
LA : Laon
LL : Lille (1685)
MC : Monaco
O : Clermont Ferand (1592; 1591-1594); 1610-1772)O : Moulin
(1549-1555)
O : Riom (1555-1591; 1591-1772)
O : Saint Pourzain (1539-1549)
P : Dijon (1539-1772)
Q : Chalon sur Saone (1539-1700)
R : Avignon
R : Nimes (1655-1658)
R : Villeneuve les Avignon: (1539-1654; 1659-1699)
R avec un lis : Gand pour la France (1815)
S : Reims (1690-1772)
S : Troyes (1539-1679)
S couronné : Troyes (1679-1690)
T : Saint Menehold (1539-1551)
T : Turin pour la France (1540-1549)
R : Rome pour la France R couronné (1812-1814)
R : Londres (1815) pour les 20F or
U : Amiens (1571-1578)
U : Troyes (1690-1772)
U : Turin Italie française (1538-1544; 1792-1814)
V : Troyes (1690-1772)
V : Turin (1539-1540)
X : Amiens (1578-1772)
X : Besançon (1693-1772)
X : Villefranche (1539-1548)
Y : Bourges (1539-1772)
Z : Grenoble (1539-1772)
Z : Saint Pouçain (1529-1531)
Dans le
but de contrôler la production et la mise en circulation
des monnaies, les autorités monétaires firent graver des
marques afin de distinguer les ateliers quand leur nom
n'apparut plus explicitement, quand les mêmes types furent
frappés par plusieurs ateliers, d'identifier le responsable
de la fabrication, le maître d'atelier essentiellement,
ou le graveur, afin aussi de distinguer les différentes
émissions d'une même espèce du même type dont les conditions
avaient été modifiées par une mutation.
Ces systèmes
de différents étaient des codes dont le déchiffrement
ne nous est guère permis que lorsqu'on dispose de sources
écrites qui les explicitent. Au Moyen Âge, le différent
est matérialisé par un motif placé dans le type principal,
en cantonnement de la croix, en remplacement de la croisette
initiale de la légende, en fin de légende, en ponctuation
ou séparation des mots de cette légende, ou encore sous
telle lettre de la légende, ou par modification de la
forme d'une lettre.
Les différents d'ateliers correspondent donc avec la relative
uniformisation d'un monnayage par une autorité qui dispose
de plusieurs unités de fabrication. Ainsi au XIIIesiècle,
temps du denier tournois monnaie unique du roi, des ponctuations
diférentes affectent les légendes sans qu'on puisse les
interpréter, ni même affirmer qu'il s'agisse uniquement
de différents d'ateliers. Même lorsque les symboles distinctifs
se multiplient sur le monnayage étoffé de Philippe le
Bel, nous n'en avons pas encore la clef de lecture.
Au XIVesiècle,
il y eut de façon certaine des différents d'ateliers sur
les monnaies royales, mais choisis librement par les maîtres
plus que par l'administration centrale des monnaies. Quelques
différents par symbole ou lettres ont été déchiffrés pour
des ateliers de Jean le Bon. Après 1360, l'Aquitaine anglaise
distingue ses ateliers par l'initiale du nom de lieu en
fin de légende, comme P pour Poitiers.
Après la
reconquête, Charles V conserve ce système. Ce choix fut
aussi utilisé dans le duché de Bretagne.
En 1389, les monnaies royales françaises furent marquées
d'un point secret, placé sous une lettre précise de la
légende, le point sous cette lettre indiquant l'atelier.
Ainsi l'atelier de Paris était représenté par un point
sous la 18e lettre de la légende. Par la suite, ce système
ne fut pas le seul utilisé pour différencier les ateliers.
Dans le royaume divisé de "l'après-Azincourt",
le Dauphin Charles donna des lettres en fin de légendes
aux ateliers ouverts par lui et les Anglais un symbole
à la place de la croisette initiale, couronne, léopard.
Dans la seconde phase de son règne (1436-1461), Charles
VII a tant d'ateliers, même s'ils ne fonctionnent pas
en même temps, que lettres et symboles sont autant utilisés
comme différents que les points secrets, les lettres des
légendes n'étant pas assez nombreuses.
Après la
reconquête et malgré la fermeture de nombreux ateliers,
ces particularités persistèrent par tradition, par commodité.
En 1540, on décida que les points secrets seraient remplacés
par des lettres d'atelier, placées à l'exergue dans le
champ. Paris avait ainsi la lettre A. On la plaçait parfois
au cœur de la croix du revers, puis elle coupa la légende
quand il n'y eut plus de séparation marquée avec le champ.
Cependant, des points secrets subsistèrent concurrement
aux lettres pour quelques ateliers jusqu'au règne de Louis
XIII. Quelques symboles survécurent sous François Ieret
Henri II, d'autres réapparurent momentanément à la faveur
des désordres liés aux guerres de Religion et d'autres
encore apparurent après des annexions, en Béarn, à Besançon,
ou bien on doubla la lettre, MM puis AA à Metz, LL à Lille,
BB à Strasbourg.
Ce système survécut à la Révolution et perdura jusqu'à
ce que Paris reste le seul atelier français (1878).
Les différents de maître d'atelier ou de graveur prirent
d'abord les emplacements et les formes les plus variées,
se combinant parfois avec le différent d'atelier, puis
à partir du XVIesiècle furent généralement placés en fin
de légende de revers, avant le millésime quand il y en
eut. À partir de la Révolution, généralisant une pratique
amorcée au XVIIIesiècle, les marques des directeurs d'ateliers
et des graveurs généraux furent gravées à l'exergue des
pièces. Depuis 1880, la corne d'abondance symbolisant
la Monnaie de Paris remplace la marque de directeur. On
reproduisait en outre la signature du graveur ayant créé
le type empreint sur la pièce. Ces usages sont encore
en vigueur actuellement.
La nouvelle émission d'une monnaie à un titre et un poids
différents, décision de l'autorité émettrice, se traduisait
dans une marque distinctive choisie par elle. Ce fut d'abord
souvent le cantonnement de la croix par un symbole, qu'on
pouvait déplacer d'un canton à un autre, puis qu'on multipliait,
qu'on remplaçait par un autre ou auquel on ajoutait un
autre symbole. Comme une certaine logique présidait au
choix de ces différents d'émission, on peut, en l'absence
de sources d'archive, essayer de reconstituer l'ordre
de la série.
Ensuite,
d'autres modes se développèrent en plus. On modifia la
ponctuation de la légende, une lettre de la légende, la
croisette initiale, un élément du type, la marque d'atelier.
Cependant ces différents manifestant souvent une altération
monétaire devaient être plus discrets que les autres,
voire secrets.
 Paris
Paris Lilles
Lilles